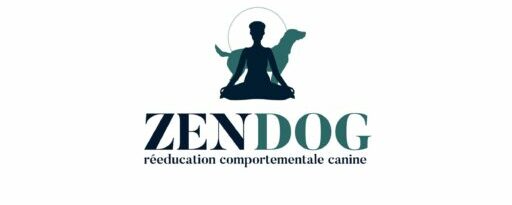Il n’y a plus de doutes aujourd’hui concernant certains pans de la cognition et de la sensibilité des chiens: leur relation avec l’humain va bien au-delà d’un simple attachement affectif. Je me suis récemment rappelé une étude menée par Kazuo Fujita et ses collègues à Kyoto University en 2015, qui m’avait interpellé par ses implications pour notre compréhension de l’intelligence sociale canine. Dans cette recherche, l’objectif était de déterminer si les chiens pouvaient évaluer le comportement d’un individu à l’égard de leur propriétaire, indépendamment d’un bénéfice direct pour eux-mêmes.
D’après ces données, il semblerait que les chiens surveillent en permanence les interactions sociales de leurs propriétaires avec d’autres personnes. De plus, nos compagnons utiliseraient ces observations pour se forger une opinion sur les individus avec lesquels nous interagissons. En d’autres termes, si une personne manque de respect, se montre peu serviable ou hostile envers le propriétaire du chien, celui-ci aura tendance à l’éviter ou à l’ignorer lors de futures interactions. Ce comportement est exactement le même que celui observé chez de jeunes enfants humains dans des situations similaires.
Cette réaction a été démontrée chez l’enfant dans une étude menée par l’Institut Max Planck d’Anthropologie Évolutive et publiée dans la revue Child Development. Dans cette recherche, des enfants de trois ans ont observé un acteur adopter un comportement hostile envers une autre personne (par exemple, en déchirant un dessin réalisé par cette dernière). Plus tard, lorsque cet acteur avait besoin d’un ballon pour jouer, les enfants étaient moins enclins à l’aider et préféraient donner le ballon à une personne ayant agi de manière amicale ou neutre.
L’étude menée par une équipe de chercheurs du laboratoire dirigé par Kazuo Fujita, professeur de psychologie et de cognition comparée à l’Université de Kyoto au Japon, a cherché à savoir si les chiens adoptaient un comportement similaire. Cette étude a été publiée dans la revue Animal Behaviour.
L’écoute sociale chez les chiens
Observer les interactions entre individus est souvent qualifié d’ »écoute sociale » (social eavesdropping). Chez l’humain, ce mécanisme est très utile pour récolter des informations sur les autres sans prendre de risques. Cela permet d’adapter ses propres réactions en fonction des comportements observés.
L’équipe de Fujita avait déjà démontré dans des études antérieures que les chiens observent attentivement les humains et utilisent ces informations pour distinguer les personnes égoïstes de celles qui sont plus généreuses. Par exemple, lorsqu’on leur donne la possibilité de quémander de la nourriture, ils privilégient les personnes perçues comme généreuses. Cependant, il n’était pas clair si les chiens observaient ces interactions uniquement dans leur propre intérêt (pour savoir à qui demander à manger) ou s’ils cherchaient à se forger une opinion sur les individus.
L’expérience
Pour éviter toute influence liée à la nourriture, les chercheurs ont mis en place une interaction sociale centrée sur un objet sans intérêt pour les chiens : un rouleau de ruban adhésif enfermé dans un récipient transparent. Au total, 54 chiens et leurs propriétaires ont participé à l’expérience. Le chien assistait à une scène où son maître tentait d’ouvrir le récipient sans succès.
Trois situations étaient testées :
- Le propriétaire demandait de l’aide à un acteur qui lui apportait son soutien en maintenant le récipient.
- L’acteur refusait d’aider et détournait le regard.
- Une situation neutre où aucune demande d’aide n’était formulée.
L’enjeu était d’observer si le chien était influencé par le comportement de l’acteur vis-à-vis de son maître. Après chaque interaction, l’acteur et un observateur neutre offraient une friandise au chien. Les chercheurs ont ensuite analysé les préférences des chiens.
Les résultats
Les résultats montrent que ce n’est qu’après avoir observé un acteur refuser d’aider leur propriétaire que les chiens changeaient de comportement. Ils évitaient alors de prendre une friandise de la main de cette personne et préféraient l’accepter de l’observateur neutre. En revanche, lorsque l’acteur se montrait serviable, les chiens n’exprimaient aucune préférence : ils prenaient les friandises indifféremment de l’acteur ou de l’observateur neutre.
Fujita a cherché à expliquer ce résultat inattendu. Il a suggéré que les chiens considèrent peut-être l’aide comme une norme sociale attendue. Autrement dit, pour eux, être serviable est la règle, donc un comportement altruiste n’est pas perçu comme exceptionnel. En revanche, un comportement négatif va à l’encontre de cette norme et suscite une réaction de méfiance.
Ce comportement est d’ailleurs similaire à celui des jeunes enfants. Dans l’étude mentionnée plus tôt, les enfants refusaient d’aider une personne hostile, mais ne montraient pas de préférence entre une personne neutre et une personne bienveillante.
Une leçon sur la nature sociale des chiens
Sur le plan scientifique, ces résultats montrent que les chiens évaluent les gens en fonction de la manière dont ils interagissent avec leurs proches. D’un point de vue philosophique, cette étude amène une réflexion plus large : les chiens et les jeunes enfants semblent partir du principe que le monde et ses habitants sont coopératifs et bienveillants. Ce n’est que lorsqu’ils sont confrontés à des comportements négatifs qu’ils modifient leur perception.
Si nous devions tirer une leçon de cette étude, ce serait celle du serment d’Hippocrate : D’abord, ne pas nuire. Autrement dit, nous devrions nous efforcer d’être bienveillants, du moins lorsque nos chiens – et nos enfants – nous regardent.
Pour moi, cette étude illustre de manière probante ce que j’ai souvent observé dans mon quotidien : certains chiens semblent savoir instinctivement qui, dans leur environnement, mérite sa confiance et son attention. La capacité des chiens à discriminer entre des comportements humains divergents démontre ce que certains chercheurs appellent une « intelligence sociale ». Cette intelligence ne se limite pas à la simple compréhension des gestes ou des commandes, mais englobe également l’évaluation des relations interpersonnelles et la capacité à adapter leur comportement en fonction de la qualité des interactions auxquelles ils assistent.
D’une part, ils soulignent que l’histoire de la domestication des chiens avec les humains a permis le développement de mécanismes cognitifs complexes, lesquels leur permettent de capter des indices subtils dans le comportement humain. D’autre part, ces découvertes ouvrent la voie à des applications pratiques, notamment dans le domaine de l’assistance et de la thérapie. Comprendre que les chiens peuvent évaluer la fiabilité d’une personne suggère que leur formation pourrait intégrer des éléments de reconnaissance des attitudes sociales, afin d’optimiser leur rôle de compagnons ou d’assistants pour des personnes vulnérables.
Cette recherche de Fujita et al. m’a également amené à réfléchir à la manière dont nous, humains, interprétons parfois à tort le comportement de nos compagnons. Trop souvent, nous attribuons aux chiens des réactions purement impulsives ou basées sur la recherche de récompense immédiate. Or, il apparaît que leur répertoire comportemental est en réalité le reflet d’une sensibilité sociale développée au fil de millénaires de cohabitation avec l’homme. En observant un chien refuser de s’approcher d’une personne qui s’est montrée hostile ou désintéressée envers son propriétaire, on assiste à une manifestation de cette intelligence sociale, qui, de surcroît, se déploie sans qu’aucun apprentissage formel ne soit nécessaire.
L’étude de Chijiiwa et al. (2015) présente toutefois plusieurs limites qui méritent d’être discutées pour mieux interpréter ses résultats et envisager des recherches futures.Premièrement, la taille de l’échantillon et la diversité des participants. Si au départ 54 chiens participants à cette étude, 26 ont été exclus soit parce qu’ils n’ont pas passé les tests préliminaires de motivation (16), soit parce que les opérateurs se sont trompé dans le protocole (10). La variabilité interindividuelle – notamment en termes de races, d’âge et d’expérience avec les humains – pourrait influencer la sensibilité aux signaux sociaux, limitant ainsi la généralisation des conclusions à l’ensemble de la population canine.
Deuxièmement, le protocole repose sur une tâche artificielle où le propriétaire tente d’ouvrir un contenant contenant un objet sans réelle valeur pour le chien. Cette situation, bien qu’utile pour contrôler les variables expérimentales, pourrait ne pas refléter fidèlement les interactions sociales naturelles auxquelles les chiens sont confrontés dans leur environnement quotidien.
Un autre point concerne le contrôle des indices involontaires. Malgré les efforts méthodologiques visant à éliminer toute communication non verbale (les acteurs ne regardant pas le chien, par exemple), il demeure possible que des signaux subtils, notamment émis par le propriétaire, aient pu influencer inconsciemment les choix des chiens.
De plus, un cas particulier – un chien dans la condition Nonhelper qui a choisi l’acteur dans toutes les épreuves – a eu un impact sur la significativité statistique de certaines comparaisons. Ce genre de comportement atypique soulève la question de l’uniformité des réponses au sein du groupe, et suggère que des investigations supplémentaires avec des échantillons plus larges pourraient être nécessaires pour confirmer ces tendances.
Enfin, bien que l’étude démontre que les chiens évitent une personne qui refuse d’aider leur propriétaire, il reste à déterminer si cette capacité d’évaluation sociale se traduit par des comportements dans des contextes plus complexes, tels que la formation d’une réputation ou l’intégration d’informations plus nuancées issues de plusieurs interactions. Ainsi, l’écologie du comportement et l’applicabilité des résultats dans des situations réelles demeurent des questions ouvertes.
Ces limites invitent à envisager des protocoles complémentaires, éventuellement dans des environnements plus naturels et avec des tâches ayant une signification plus immédiate pour le chien, afin de mieux cerner l’étendue et les mécanismes de l’évaluation sociale chez les canidés.
Personnellement, je trouve que ces résultats renforcent l’idée que notre relation avec nos chiens est profondément ancrée dans une histoire évolutive commune et que, malgré les limites inhérentes à cette étude, ils témoignent néanmoins de la capacité des chiens à transcender de simples stimuli environnementaux pour évaluer des aspects plus complexes de la communication humaine. En effet, ces résultats suggèrent que, même dans un contexte contrôlé, les chiens intègrent non seulement des signaux visuels et acoustiques, mais aussi des indices issus du comportement social, pour porter des jugements affectifs sur les personnes qui interagissent avec leur propriétaire.
En conclusion, l’étude de Fujita et ses collaborateurs apporte des preuves convaincantes – bien que dans un cadre expérimental limité – que les chiens sont capables de discerner, à partir d’un simple échange social, la qualité d’un individu. Leur comportement, qui privilégie systématiquement les personnes neutres ou aidantes face à celles qui se montrent négatives envers leur propriétaire, illustre de manière frappante leur intelligence sociale. Pour moi, cette recherche confirme ce que j’ai toujours ressenti en observant nos compagnons : le chien ne se contente pas de vivre en marge de l’Homme, il participe activement à l’évaluation de son environnement social, faisant preuve d’un discernement qui rappelle, à certains égards, des capacités cognitives que l’on retrouve chez les humains.
Ces résultats, tout en invitant à repenser notre approche de la relation homme-chien et en ouvrant de nouvelles perspectives quant aux applications pratiques de cette intelligence sociale. D’une part, ils soulignent que l’histoire de la domestication des chiens avec les humains a permis le développement de mécanismes cognitifs complexes, lesquels leur permettent de capter des indices subtils dans le comportement humain. D’autre part, ces découvertes ouvrent la voie à des applications pratiques, notamment dans le domaine de l’assistance et de la thérapie. Comprendre que les chiens peuvent évaluer la fiabilité d’une personne suggère que leur formation pourrait intégrer des éléments de reconnaissance des attitudes sociales, afin d’optimiser leur rôle de compagnons ou d’assistants pour des personnes vulnérables. Cette étude nous rappelle également la nécessité de poursuivre des recherches dans des contextes plus naturels et avec des échantillons plus larges. Comprendre et valoriser ces aptitudes naturelles, tout en reconnaissant les limites de l’étude, peut enrichir encore davantage notre coexistence avec ces animaux si fidèles et sensibles.
sources:
Amrisha Vaish, Melinda Carpenter, & Michael Tomasello, (2010). Young children selectively avoid helping people with harmful intentions. Child Development, 81, 1661-1669.
Hitomi Chijiiwa, Hika Kuroshima, Yusuke Hori, James R. Anderson & Kazuo Fujita (2015). Dogs avoid people who behave negatively to their owner: third-party affective evaluation. Animal Behaviour, 106, 123-127